La police, vigie d’un territoire rural en mouvement
Tandis que les allées bruissent des échanges entre exposants et visiteurs sur le champ de Foire, un autre dispositif, plus discret, se déploie en arrière-plan. Celui de la zone de police Centre Ardenne, chargée d’assurer le bon déroulement de la manifestation. À sa tête, le commissaire divisionnaire Laurent Halleux pilote avec rigueur la coordination des services de sécurité. Nous l’avons rencontré.
Installé dans les locaux sobres du commissariat de Bastogne, Laurent Halleux dirige une équipe de près de 130 policiers, appuyés par une trentaine de collaborateurs civils.
Un vaste territoire rural sous surveillance constante
La zone couvre non moins de sept communes (Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Léglise, Libramont-Chevigny, Neufchâteau, Vaux-sur-Sûre). Le chef de corps, grade le plus élevé dans la hiérarchie de la police intégrée belge, assume à la fois des responsabilités de gestion administrative et opérationnelle. « Mon rôle s’apparente à celui d’un chef d’entreprise », explique-t-il. « Je veille à la bonne application des lois, mais aussi à ce que mes équipes puissent accomplir leur mission dans des conditions optimales. »
Chaque mois de juillet, le territoire voit son activité s’intensifier avec l’arrivée de la Foire. Durant quatre jours, plus de 200.000 visiteurs convergent vers le site transformé en vaste vitrine du monde agricole.
Un dispositif de sécurité pensé pour la fluidité
La présence policière, bien que massive, se veut la plus discrète possible. « Nous mobilisons entre 150 et 160 agents dès le premier jour, déployés sur l’ensemble du site et ses abords », indique Laurent Halleux. La priorité sera de garantir la sécurité de tous et maintenir une mobilité suffisante pour les services de secours.
La stratégie repose sur une répartition différenciée : à l’extérieur du site, la circulation, les accès et le stationnement sont sous la responsabilité des forces publiques, tandis qu’à l’intérieur, la gestion est en grande partie confiée à des agents de sécurité privés.
Dès le mois de mai, les préparatifs s’intensifient. Analyse des risques, planification, coordination avec les autres services : tout est passé au crible. Des scénarios sont élaborés pour couvrir un large éventail de situations, des plus courantes (rixes, vols, dégradations) aux plus graves. « La consommation d’alcool reste un facteur de risque important. Une présence dissuasive permet souvent d’éviter les débordements », note-t-il. Mais les hypothèses les plus extrêmes ne sont plus exclues. Attaque à la voiture-bélier, agression armée, action spectaculaire : tout est envisagé. « Ce n’est jamais agréable à dire, mais le contexte européen nous oblige à une vigilance constante. »
Un souvenir encore vif dans les esprits
La prudence s’enracine aussi dans la mémoire collective. À la fin des années 1990, un incident marquant est venu troubler le calme apparent de la Foire de Libramont lorsque Paul De Keersmaeker, alors secrétaire d’État à l’Agriculture, y avait été violemment pris à partie par des manifestants. Bousculé, insulté, il avait dû être exfiltré en urgence sous protection policière se souvient le commissaire. Cet épisode, encore évoqué au sein des services, a laissé une empreinte durable.
Depuis lors, la sécurité des personnalités politiques présentes sur le site fait l’objet d’une attention particulière, devenue une priorité absolue pour les forces de l’ordre. « Cet événement rappelle à quel point une tension mal canalisée peut dégénérer. »
Une police attentive aux réalités du monde agricole
Sur ce territoire à forte tradition agricole, les liens entre forces de l’ordre et exploitants sont anciens et souvent personnels. « Plusieurs de nos agents de quartier sont issus du milieu agricole ou en connaissent bien les réalités », souligne Laurent Halleux. En amont de la Foire, ce tissu relationnel est renforcé par la collaboration avec la police fédérale, notamment à travers les cellules d’information sur l’ordre public (Ciop). Ces dernières collectent des « EEI » (éléments essentiels d’information) échangés entre zones de police à l’échelle nationale. L’objectif est de détecter d’éventuelles intentions d’actions revendicatives.
Mais ce travail de renseignement ne vise pas à réprimer. « Nous comprenons les inquiétudes et les colères, en particulier dans un contexte économique tendu. Notre but est d’anticiper, pour prévenir les débordements ».
Lorsqu’une action est annoncée, la doctrine est claire : permettre l’expression tout en assurant la sécurité. « Il vaut mieux encadrer un cortège de tracteurs que chercher à l’interdire. Nous proposons des itinéraires, nous assurons les accès. L’objectif est de garantir la liberté d’expression dans un cadre apaisé » développe-t-il. Certains points sensibles, tels que les dépôts de la grande distribution, restent sous surveillance. « Mais nous privilégions toujours une réponse proportionnée. Les blocages frontaux ne font souvent qu’attiser les tensions ».
La proximité ancrée sur le terrain
En dehors de la Foire, les contacts avec le monde agricole se poursuivent, de manière plus diffuse. « Nous restons attentifs aux vols de matériel, aux animaux divagants, ou encore aux GPS dérobés dans les tracteurs », explique Laurent Halleux. La zone Centre Ardenne, relativement épargnée par certains phénomènes urbains, n’en demeure pas moins vigilante. « Informer, prévenir, c’est aussi notre mission ».
Pour le chef de corps, l’action policière repose avant tout sur une proximité réelle avec le territoire. « Notre rôle n’est pas de compliquer la vie des gens. Nous sommes là pour aider, pour résoudre les problèmes. Le bon sens, l’écoute et la confiance doivent rester les fondements de notre engagement ».
Et de glisser : « Quand on agit avec respect et qu’on comprend les réalités du terrain, les gens nous le rendent bien. C’est dans cette relation que réside notre efficacité ».
Marie-France Vienne








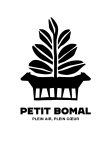
-autox150.png)
