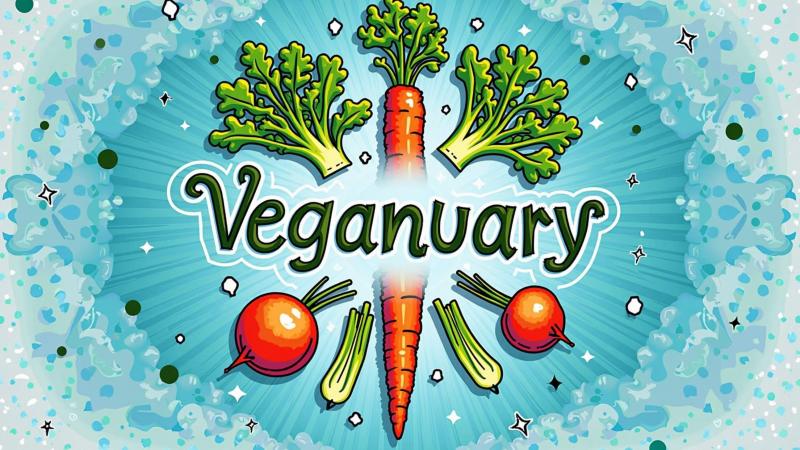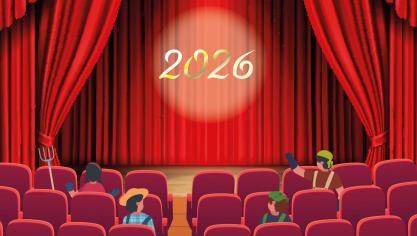L’inaction en héritage

À la Foire de Libramont, le défi du renouvellement des générations en agriculture s’est invité en filigrane de toutes les discussions et s’affirme désormais comme l’un des pivots de l’avenir rural en Europe. En Wallonie, plus d’un agriculteur sur deux a dépassé les 50 ans. D’ici dix ans, 8.000 des 12.500 exploitations actuelles pourraient cesser leur activité. À peine 20 % des cédants identifient aujourd’hui un repreneur. Ce constat reflète une tendance lourde à l’échelle de l’UE : la disparition progressive d’exploitations familiales, l’allongement de la carrière des exploitants, le découragement des jeunes face à des obstacles multiples.
Face à cette situation, la commission affirme faire du renouvellement générationnel une priorité. Le commissaire Christophe Hansen a rappelé que la nouvelle politique agricole commune mobilisait 8,5 milliards € en soutien aux jeunes agriculteurs, complétés par 3 milliards d’engagements de la Banque européenne d’investissement. Des sommes conséquentes, mais encore très théoriques pour ceux qui, sur le terrain, peinent à accéder à la terre ou à faire aboutir leur projet. La Pac prévoit certes un « starter pack » que les États membres devront décliner (aides à l’installation, accompagnement à l’investissement, formation, services de remplacement), et la commission annonce la publication, à l’automne, d’une stratégie spécifique sur le renouvellement des générations. Mais pour les jeunes agriculteurs, l’attente se double désormais d’une exigence : celle de voir les intentions traduites en actions. Le Ceja n’a pas hésité à dénoncer un « renoncement silencieux ». Selon lui, les textes actuels manquent d’ambition financière, et paraissent en décalage avec l’urgence démographique que traverse l’agriculture européenne.
L’accès au foncier est au cœur de cette problématique. « Sans terre, il n’est pas possible de produire », a récemment rappelé M. Hansen. Or, dans de nombreuses régions, la pression sur le foncier s’intensifie, alimentée par l’arrivée d’acteurs non agricoles qui investissent massivement dans les terres, sans en assurer l’exploitation directe. La définition de « l’agriculteur actif », encore floue, devient ainsi une question politique déterminante. L’observatoire européen des terres, récemment mis en place, pourrait offrir des éléments de diagnostic utiles, mais la régulation reste, pour l’heure, lacunaire. Quant à l’installation agricole, elle ne peut se penser isolément. Elle exige une approche systémique, coordonnée, intersectorielle. À l’heure où la commission s’apprête à dévoiler sa stratégie en matière de renouvellement générationnel, le moment est venu de passer de la parole aux actes. Car ce qui se joue, derrière les chiffres et les budgets, c’est la capacité de l’UE à garantir la continuité de son modèle agricole, à préserver la diversité de ses exploitations, à assurer la transmission d’un patrimoine de compétences et de savoir-faire. Le défi est immense. L’indifférence, elle, n’est plus permise.