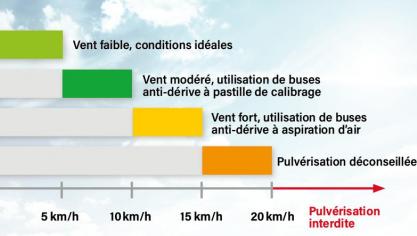Règlement européen sur l’utilisation durable des pesticides (SUR) :«Nous ne voulons pas effrayer les agriculteurs»…
Le parlement européen a validé, la semaine dernière, un rapport portant sur le règlement relatif à l’usage durable des pesticides. Un texte audacieux qui revoit à la hausse certaines ambitions de la commission en termes de réduction des produits phytosanitaires. Rapporteure du texte, l’écologiste autrichienne Sarah Wiener est venu longuement s’en expliquer devant la presse à l’issue des débats.

Les discussions furent parfois volcaniques sur une directive aussi clivante que ne l’est la loi sur la restauration de la nature. C’est dire la férocité des échanges auxquels l’écologiste a été confrontée.
La rapporteure accusée « d’éco-populisme »
Sarah Wiener a tout d’abord dû fermement réfuter les accusations « d’éco-populisme » dont le seul but était de bannir totalement les pesticides. Des propos venus des rangs de la droite, PPE en tête, et de son extrême.
Elle a ensuite regretté l’absence de compromis avec une partie de la droite et l’attitude du président de la commission de l’Agriculture, Norbert Lins, lui aussi issu de cette formation politique avec lequel elle espère néanmoins trouver un terrain d’entente.
Et si une majorité solide a pu finalement être dégagée, « c’est parce que les autres partis s’inscrivent en faveur de la biodiversité, de la lutte contre la crise climatique et la possibilité d’offrir davantage de stabilité aux agriculteurs » s’est-elle rassurée.
Élargissement
de la période de référenceDans le texte adopté par 47 voix pour, 37 voix contre et 2 abstentions, les députés plaident pour une réduction, d’ici 2030, de l’utilisation et du risque des produits phytopharmaceutiques chimiques d’au moins 50 % et de l’utilisation de produits plus dangereux (produits de substitutions) de 65 %, par rapport à la moyenne de la période 2013-2017.
Pour rappel, la commission avait proposé un objectif de 50 % pour les deux, sur la base de la moyenne 2015-2017. La nouvelle période de référence élargie proposée par le parlement permettrait de mieux prendre en compte les efforts déjà entrepris dans les États membres.
Des chiffres précis,
mais réalistes ?Les réductions iraient de 15 % à 65 % en fonction de l’intensité d’utilisation dans les États membres. Il serait fixé à -15 % lorsque l’intensité d’utilisation d’un État membre au cours de la moyenne des années 2013 à 2017 est inférieure à 35 % de la moyenne de l’UE, à -35 % pour ceux dont l’utilisation est inférieure à 70 % de la moyenne, à -50 % pour une utilisation se situant entre 70 % et 140 % de la moyenne et à 65 % lorsque l’intensité d’utilisation est supérieure à 140 %.
Les eurodéputés veulent par ailleurs ajouter un second objectif de réduction de 65 % de l’utilisation des pesticides les plus dangereux, « même si elle était de 80 % dans ma proposition » a précisé la députée autrichienne qui s’est, dans la foulée, défendue de vouloir « effrayer les agriculteurs ».
Pour atténuer la portée des chiffres avancés, la rapporteure écologiste a d’ailleurs mis en avant les conseils et autres aides et accompagnement qui leur seront prodigués.
« Nous pouvons aussi apprendre des agriculteurs engagés en bio » (selon Eurostat 15,9 millions d’hectares étaient cultivés biologiquement ou étaient en cours de conversion en 2021 dans l’UE, soit 9,9 % des terres agricoles) a-t-elle avancé en réitérant l’objectif de « réduire les poisons que l’on injecte dans l’environnement ».
« Les mêmes règles du jeu pour tout le monde »
Quid des zones sensibles ?
Le document offre toutefois des possibilités de dérogations « pour assurer la viabilité à long terme des activités agricoles ou pour sauvegarder la culture de semences » ainsi que des flexibilités dans la délimitation de ces zones.
Le courroux du Copa-Cogeca
Une session plénière
sous haute tension