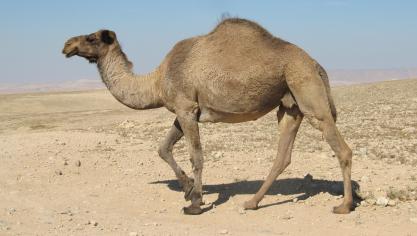«Les pisciculteurs wallons sont des ingénieurs de l’eau»
Loin des sentes et loin des routes, le bruit de l’eau, le menu flot sur les cailloux, il passe, il court et glisse. Quelques mots pêchés chez Verhaeren pour évoquer ruisseaux et autres étangs où filent et se faufilent les poissons. Univers du silence et de la joie, de l’impermanence et de l’insouciance. Mais aussi de notre patrimoine wallon et de son tissu économique. Petite immersion en eau douce, avec la complicité de Bertand Hoc, bioingénieur, titulaire d’un master complémentaire en aquaculture, pêcheur passionné et chargé de mission au sein du Collège des Producteurs.

Aquaculture, pisciculture, deux termes dont les profanes en la matière peuvent aisément faire mésusage en raison du flou qui les entoure. Ces deux activités qui sont liées à l’élevage d’organismes aquatiques, se distinguent par la nature des espèces élevées et les techniques utilisées.
Aquaculture, pisciculture, du bon usage des termes
L’aquaculture est un terme générique qui englobe l’élevage de tous types d’organismes aquatiques, dans des environnements contrôlés ou semi-contrôlés. Elle inclut les poissons (comme dans la pisciculture), les mollusques (huîtres, moules, etc.), les crustacés (crevettes, crabes, etc.), les algues, et tous les autres organismes aquatiques comme les coraux ou les plantes aquatiques.
Elle se pratique en eau douce, en eau salée ou en eau saumâtre (mélange de douce et salée), et ses objectifs varient, allant de la production alimentaire à l’amélioration des écosystèmes (comme la réintroduction d’espèces en milieu naturel ou la restauration des récifs).
La pisciculture est, quant à elle, une branche de l’aquaculture spécifiquement consacrée à l’élevage de poissons à des visées d’alimentation, de pêche sportive ou de la réintroduction dans les milieux naturels. Les poissons élevés en pisciculture peuvent être d’eau douce (comme la truite ou la carpe) ou d’eau salée (comme le bar ou la dorade).
« En Wallonie, on ne pratique que de la pisciculture, même si l’on pourrait très bien faire de l’écrevisse en eau douce » sourit Bertrand Hoc qui évoque aussi la cypriniculture, branche spécifique de la pisciculture, dédiée à l’élevage de poissons d’étang, incluant la carpe, le gardon, la tanche, le rotengle, la brème, le carassin…
La carpe, premier poisson d’élevage en Wallonie
L’élevage de poissons est une discipline qui se pratiquait déjà il y a 4.000 ans en Égypte. Ailleurs sur la planète, les Asiatiques produisaient de la carpe voici 3.000 ans, un poisson introduit 2.000 ans plus tard en Europe par les Romains.
Et ce sont les moines wallons qui commenceront à l’élever, il y a 600 ans, dans notre région. Mieux, ils pratiquaient déjà, à force de patience, la sélection pour produire des carpes sans écailles !
« On en retrouve partout, dans nos cours d’eau, dans les plans d’eau de loisir et d’ornement, dans les douves des châteaux… » développe M. Hoc avant d’ajouter que « tout le monde, jadis, en avait sur son assiette ».
Et de nous apprendre que cette espèce est le poisson d’eau douce le plus consommé dans le monde. Croissance rapide, omnivore, résistant au réchauffement climatique, ce poisson a en outre l’avantage de pouvoir se nourrir de toute une série de coproduits de l’agriculture wallonne.
Contrairement aux idées reçues, c’est seulement en 1889 que naît la première pisciculture moderne en Wallonie. Et cela fait moins de 150 ans que l’on fait de la truite en Wallonie.
La truite, reine du terroir wallon
À l’heure actuelle, la truite est indissociable du terroir wallon. On en distingue deux espèces : la fario, indigène des rivières wallonnes mais que l’on retrouve dans l’ensemble du bassin européen, a été l’un des premiers poissons à être élevé. Elle est bien adaptée aux eaux froides et oxygénées des cours d’eau wallons.
La deuxième espèce a été importée d’Amérique du Nord au XIXe siècle. C’est la truite arc-en-ciel qui a rapidement été adoptée en pisciculture pour sa croissance rapide et sa résistance aux conditions d’élevage.
Quant à la production de salmonidés en Wallonie, elle est également orientée vers le repeuplement des rivières et étangs de pêches.
Le big-bang de la concurrence danoise et turque
La Wallonie ne compte malheureusement qu’un peu moins de 40 pisciculteurs sur son territoire contre 120 dans les années 90, au moment où la truite était alors considérée comme « l’or vert ». Mais c’était avant que le paysage de la salmoniculture ne change avec l’explosion de la production danoise dont la Belgique devient l’une des meilleures clientes tandis que la Turquie commence à empiler de gigantesques sites de production sur son territoire. Une concurrence qui a logiquement fait plonger notre marché dans la tension. En cause, la faible compétitivité de la truite wallonne sur les marchés de masse, en raison de son coût de production plus élevé.
C’est en maintenant une qualité des produits bien plus élevée que ceux qui sont importés et en se diversifiant (méthode de fumaison, recettes artisanales, mousses, rillettes…) que les salmoniculteurs wallons ont tenu le choc.
Le secteur est aussi confronté à des maladies virales à déclaration obligatoire que sont la NHI et la SHV. « Leur introduction au sein d’un cheptel constitue une véritable catastrophe pour l’éleveur » prévient Bertrand Hoc.
La cypriniculture dans le dur
La filière piscicole wallonne est en pleine période de transition. « Certains sont en phase de transmission ou de cessation de leur exploitation, car il faut savoir que la majorité des pisciculteurs ont plus de 50 ans, certains ayant même plus de 65 ans ».
Une petite éclaircie vient toutefois de la reprise de deux sites par des jeunes de moins de 30 ans. Quant aux cypriniculteurs de poissons d’étangs, la situation est encore plus critique, puisqu’ils ne sont plus que… deux !
Une formation d’aquaculteur en 2025
Les raisons d’espérer sont pourtant bien réelles en raison du niveau de compétences « particulièrement élevé » des pisciculteurs wallons se réjouit M. Hoc qui travaille à la mise en place d’une formation professionnalisante. Et de nous confier qu’il n’en existe étonnamment aucune, les pisciculteurs étant tous des « passionnés autodidactes, des ingénieurs de l’eau » qui ne bénéficient hélas que de peu de visibilité. Seuls les deux jeunes qui viennent de reprendre une exploitation organisent des visites.
La formation professionnalisante d’aquaculteur (comprenant des dimensions relatives à l’aspect sanitaire, à la zootechnie, au suivi d’élevage, à la transformation…) qui sera normalement mise sur rail fin 2025, s’effectuera en partenariat avec les pisciculteurs eux-mêmes.
« Mon objectif, c’est d’aller chercher les ressources sur le terrain, de les solliciter pour dispenser des éléments de cours et transmettre leur savoir-faire » s’enthousiasme Bertrand Hoc pour qui il est « impératif de réaliser un transfert de connaissances ».