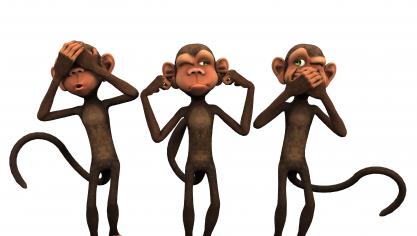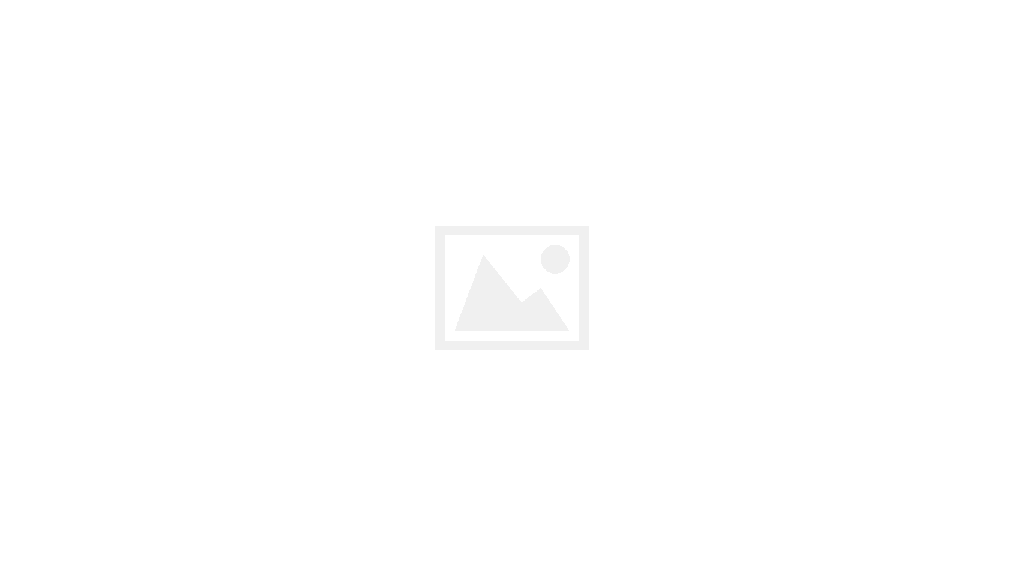L’obligation de garantie est une obligation éventuelle assumée par le vendeur d’une machine. Comme nous l’expliquons plus loin dans cet article, il est possible, dans certains cas de vendre sans aucune obligation de fournir une garantie : l’obligation de garantie n’est donc qu’une obligation éventuelle du vendeur.
L’obligation elle-même découle de l’idée de base selon laquelle le vendeur doit livrer à l’acheteur une machine adaptée à l’usage que les parties avaient à l’esprit lors de la vente. Si la machine livrée n’est plus conforme à ce qui a été convenu entre les parties, une réparation doit être effectuée pour la remettre en conformité. Par exemple, dans le cas d’un tracteur avec traction avant, celle-ci devra être réparée si elle ne fonctionne plus après quelques mois. Le fait que le coût de la réparation soit à la charge de l’acheteur ou du vendeur dépend de l’existence ou non d’une obligation de garantie.
En fonction de l’acheteur
Afin de déterminer s’il existe une obligation légale de fournir une garantie, il convient d’examiner en premier lieu la nature de l’acheteur. Selon que l’acheteur est une entreprise ou un simple particulier, un régime juridique complètement différent s’applique. À cet égard, nous rappelons que depuis plusieurs années un agriculteur est considéré comme une entreprise.
En outre, le motif de l’achat doit être pris en compte. Si un entrepreneur achète un appareil ou une machine pour son usage personnel, l’achat sera considéré comme un achat de consommation. Par conséquent, un entrepreneur peut également bénéficier de l’obligation de garantie légale applicable aux consommateurs pour les appareils et machines qu’il achète non pas à des fins professionnelles mais en tant que consommateur.
Le cas des entreprises
Lorsqu’un agriculteur achète des machines pour les utiliser dans son exploitation, cette dernière est considérée comme une entreprise. Comme dans la vaste majorité des cas le vendeur est également une entreprise, l’accord de vente est conclu entre entreprises. Dans ce cas, la loi ne prévoit pas de période de garantie minimale. Les parties sont donc totalement libres de régler cet aspect. Il est évidemment dans l’intérêt de l’acheteur de négocier la garantie la plus large possible et la période de garantie la plus longue possible, alors que le vendeur a intérêt à stipuler une période de garantie courte et une obligation de garantie limitée.
Afin d’éviter les litiges ultérieurs, quelles que soient la garantie et la période de garantie convenues entre les entrepreneurs, les parties ont intérêt à mettre par écrit leur accord relatif à la garantie. Il est préférable de le faire dans un contrat de vente qui comprend une clause relative à la garantie. Toutefois, les entreprises peuvent également fixer les dispositions relatives à la garantie dans un bon de commande ou de livraison signé pour accord, dans un accord de garantie séparé ou même dans une lettre ou un courrier électronique. La règle est la suivante : plus la garantie convenue est clairement consignée par écrit, moins il y a de place pour les désaccords par la suite.
À proprement parler, les entreprises ne sont pas obligées de définir par écrit l’étendue de la garantie et la période de garantie. Il est évident que l’acheteur qui veut invoquer une garantie aura un sérieux problème de preuve si le vendeur la conteste. De plus, si rien n’est convenu au sujet de la garantie, l’acheteur ne bénéficiera d’aucune garantie.
Le cas des consommateurs
En cas de vente à un consommateur, la situation change du tout au tout. Pour les consommateurs, il existe une protection légale minimum. La loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de biens de consommation prévoit en effet une garantie légale. Lors de l’achat d’un bien de consommation, le vendeur doit fournir une garantie pour tout défaut (de conformité) du bien qui apparaît dans les deux ans qui suivent l’achat. Bien entendu, les parties peuvent convenir d’une période de garantie plus longue, auquel cas c’est cet accord qui s’applique, car il porte la période de garantie au-delà du minimum légal. Si les parties conviennent d’une période de garantie plus courte, le consommateur pourra toujours invoquer la loi contre l’accord par la suite.
Seconde main
Dans le cas des machines d’occasion, les règles sont en grande partie les mêmes. Lors de la vente de machines d’occasion, les entreprises sont totalement libres de négocier entre elles les conditions de garantie. Lorsque des biens d’occasion sont vendus à des consommateurs, il est possible de convenir une période inférieure à deux ans. Toutefois, la garantie des machines d’occasion ne peut être inférieure à un an. Un agriculteur qui vend sa tondeuse à mouton professionnelle à un éleveur amateur sera donc toujours légalement tenu d’appliquer la garantie si la tondeuse tombe en panne dans le cadre d’une utilisation normale au cours de la première année qui suit l’achat.
Via internet
De plus en plus de marchandises, notamment d’occasion, sont aujourd’hui proposées à la vente sur internet. Dans ce cas, lorsque la vente est conclue sans que les deux parties soient physiquement présentes ensemble et que l’acheteur est un consommateur, des règles supplémentaires entrent en jeu. Lors d’une vente à distance, le consommateur-acheteur dispose également d’un droit de rétractation. Ce droit de rétractation permet au consommateur de renoncer à l’achat dans un délai de 14 jours sans avoir à donner de raison ni à payer de frais supplémentaires.
Les règles relatives à la garantie s’appliquent également à la vente à distance, par exemple suite à l’achat d’une machine sur internet par courrier électronique. Dans ce cas, il est préférable que les accords sur la garantie soient clairement énoncés dans l’e-mail par lequel l’achat est effectué. Le consommateur-acheteur bénéficiera également de la garantie minimale légale de deux ans pour les appareils et machines neufs et d’un an pour les biens d’occasion.
Vice caché
Enfin, pour être complets, nous rappelons que, conformément à l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de dédommager l’acheteur des vices cachés de la chose vendue. Il s’agit de vices cachés qui rendent la machine vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui réduisent cet usage à un point tel que l’acheteur, s’il avait connu ces vices, n’aurait pas acheté la machine ou ne l’aurait achetée qu’à un prix inférieur. Le défaut doit exister, au moins en germe, au moment de la vente. En cas de vice caché, l’acheteur peut soit exiger l’annulation de la vente, soit demander une réduction du prix. Si aucune garantie n’a été convenue, l’acheteur peut donc éventuellement intenter une action sur la base d’un vice caché.
Jan Opsommer