L’agriculture wallonne sous pression, entre adaptation et avenir incertain
Comment assurer l’avenir de l’agriculture wallonne face à l’urgence climatique, aux bouleversements géopolitiques et à l’incertitude européenne ? C’est autour de cette interrogation qu’une table ronde, organisée le 15 juillet dernier à Hannut par CBC Banque, a réuni la ministre Anne-Catherine Dalcq, Michaël Coulouse, agriculteur et hôte de l’événement, Benoît Dardenne, consultant à la FJA et Bernard Keppenne, économiste en chef au sein du bancassureur belge.

Autour de trois thèmes, climat, géopolitique, et avenir du modèle agricole, les débats ont mis en lumière les vulnérabilités du secteur, mais aussi les pistes concrètes d’adaptation et les leviers politiques encore disponibles.
« Le changement climatique va plus vite que prévu. Ce que le Giec annonçait pour 2035, nous l’avons déjà connu cette année », a alerté l’économiste Bernard Keppenne. Devant une assistance composée de journalistes mais aussi de professionnels du secteur, les intervenants ont dressé un état des lieux des plus inquiétants : sécheresses, inondations, canicules et autres aléas climatiques ne relèvent plus de l’exceptionnel mais du quotidien agricole.
Le climat, un adversaire de moins en moins abstrait
Pour Michaël Coulouse, qui s’est spécialisé dans l’aviculture et la pomme de terre, ces phénomènes se traduisent par des tensions permanentes dans l’organisation du travail : « Les fenêtres de travail sont de plus en plus courtes et intenses. Il faut toujours s’adapter et presque prévoir l’imprévu ».

Sur son exploitation, où il a inauguré en 2024 deux nouveaux poulaillers pour la production de poulets de chair, il n’a pas hésité à investir dans des bassins de rétention d’eau et a noué des partenariats avec la commune pour mieux gérer les eaux de ruissellement.
Pour la ministre Anne-Catherine Dalcq, la responsabilité ne peut peser uniquement sur les épaules des producteurs : « Les agriculteurs s’adaptent, mais ils ne peuvent pas tout assumer seuls. C’est toute la société qui doit les accompagner ». Au-delà du Fonds des calamités agricoles, promis à une refonte, la ministre a plaidé pour un véritable système assurantiel mutualisé.
Le changement climatique a aussi un coût économique. Selon une étude de la Banque centrale européenne citée par Bernard Keppenne, l’impact d’un scénario extrême pourrait représenter une perte de 5 % du PIB européen, soit l’équivalent de la crise du Covid.
Le modèle agricole wallon, historiquement adapté à une diversité de terroirs, est contraint de se réinventer, non seulement dans ses techniques culturales mais aussi dans son organisation économique. « Il faut réfléchir aussi à des productions moins dépendantes du climat, comme certaines productions hors sol ou en circuit court », a proposé Benoît Dardenne.
Le choc géopolitique, de Trump au Mercosur
Après la crise climatique, c’est un autre front qui s’ouvre, celui de la géopolitique agricole. La guerre en Ukraine, la politique protectionniste de Donald Trump, ou encore les accords commerciaux comme celui avec les pays du Mercosur pèsent lourd sur les épaules des exploitants.
« Avec Trump, des droits de douane de 30 % sont prévus dès le 1er août. Pour les produits agricoles transformés, c’est un coup dur », prévient Bernard Keppenne, ajoutant que notre pays exporte vers les États-Unis du chocolat, du beurre, des frites surgelées, du miel. « Ce n’est pas grand-chose en volume, mais c’est essentiel pour l’équilibre des filières. »
Et d’ajouter que l’Europe « doit cesser d’être un vassal des États-Unis. Elle doit défendre ses intérêts, et cela passe par des accords équilibrés ».
Dans son intervention, la ministre Dalcq a rappelé qu’à côté de l’offensive protectionniste américaine, des traités de libre-échange comme ceux qui sont en discussion avec le Mercosur ou l’Ukraine doivent être examinés avec lucidité. « On ne peut pas accepter des importations de produits cultivés avec des pesticides interdits en Europe. C’est une question de règles du jeu équitables. »
La Wallonie, assure-t-elle, s’opposera à l’accord Mercosur « en l’état ». Et d’alerter : « Avec l’accumulation des traités, certains secteurs deviennent vulnérables : la volaille, le sucre, les œufs ».
Quant aux négociations avec l’Ukraine, elle a pointé un contingent de sucre cinq fois supérieur à celui d’avant-guerre. « Or, la Belgique est l’une des régions les plus compétitives d’Europe pour la betterave sucrière. »
Et d’ajouter que l’agriculture est « trop souvent négociée en fin d’accord, alors qu’elle devrait être au cœur de la stratégie ».
Une Pac affaiblie : la souveraineté alimentaire en danger
Au cœur des inquiétudes exprimées par le secteur agricole figure l’avenir de la Pac qui vient de perdre quelque 20 % de son budget et risque d’être diluée dans un fonds plus vaste. Pour Anne-Catherine Dalcq, c’est une erreur historique : « La Pac a fait de l’Europe un continent autosuffisant. L’affaiblir, c’est mettre notre souveraineté alimentaire en péril. »
Cette politique joue un rôle crucial dans le soutien aux jeunes agriculteurs. « L’âge moyen d’un agriculteur est de 55 ans. Qui va nous nourrir dans 15 ans ? », a questionné la ministre. L’aide à l’installation, financée par le deuxième pilier de la Pac, serait directement menacée par une coupe budgétaire.
Elle a également mis en garde contre l’effet d’invisibilisation : « Si on dilue la Pac dans un fonds de cohésion plus vaste, non seulement on perdra le contrôle budgétaire, mais aussi le signal politique fort qui rappelle que nourrir l’Europe est une priorité ».
Bernard Keppenne a renchéri en appelant de ses vœux une politique forte, structurée, cohérente. « L’Europe doit réaffirmer qu’elle veut une agriculture indépendante. Et cela passe par le consommateur, qui doit accepter de payer le juste prix ».
Quelle agriculture wallonne demain ?
La troisième partie de la table ronde était tournée vers l’avenir. L’agriculture wallonne peut-elle rester familiale, diversifiée, enracinée dans ses terroirs ? Rien n’est moins sûr. « Quand j’ai repris l’exploitation, il y avait une vingtaine de familles autour. Aujourd’hui, on n’est plus que trois ou quatre », a noté un agriculteur dans un témoignage vidéo diffusé au cours de la rencontre.
C’est dire qu’il est aujourd’hui impératif de faciliter la reprise des exploitations familiales. Sans un accompagnement ciblé et durable, celles-ci risquent de disparaître, absorbées peu à peu par de grandes entités agroalimentaires. C’est tout un modèle agricole qui vacille, avec lui la diversité des paysages, le tissu de l’emploi rural, et la qualité de la production locale.
Pour Benoît Dardenne, consultant en reprise d’exploitation à la FJA, les marges se réduisent et accentuent la concentration des exploitations : « Plus les revenus diminuent, plus il faut produire pour survivre. Ce qui pousse au regroupement. » Il appelle à des stratégies différenciées, adaptées à chaque région et chaque profil d’agriculteur : « Il n’y a pas un modèle unique. Il faut du conseil, des aides ciblées, une vision ».
La ministre a mis en avant plusieurs chantiers en cours tels que l’accès au foncier, la réforme du bail à ferme, la simplification administrative, le développement de filières locales, ou encore la reconnaissance des labels de qualité (AOP, IGP). « Il faut clarifier les repères pour le consommateur et valoriser les produits issus d’une agriculture responsable ».
Et de glisser que « l’agriculture, c’est notre nourriture, notre territoire, notre identité. Si nous ne soutenons pas aujourd’hui des agriculteurs libres, demain, nous aurons des terres exploitées par des fonds d’investissement étrangers. »
Le message venu de Hannut est limpide : l’agriculture wallonne a besoin de choix politiques forts, d’un soutien sociétal massif et d’une vision européenne cohérente. Ce n’est qu’à ce prix que le monde agricole pourra continuer à jouer son rôle essentiel : nourrir, entretenir les paysages, et faire vivre les territoires.







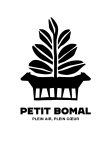
-autox150.png)
