Accord UE-États-Unis: l’agriculture en suspens
Dans le secteur agricole, l’accord conclu le 27 juillet en Écosse entre Ursula von der Leyen et Donald Trump pose davantage de questions qu’il n’offre de réponses.

Mais les détails techniques de cette entente restent encore flous et suspendus à des discussions qui devraient se poursuivre. Cette incertitude pèse sur le secteur agroalimentaire, notamment la filière vin, en première ligne face aux sanctions. Des exemptions sont attendues, et poussées notamment par la France, mais elles ne devraient pas se matérialiser dans la première tranche. En sens inverse, un meilleur accès est promis à des produits agricoles américains non sensibles pour l’Europe (céréales, noix…). Au-delà du fond, la forme utilisée pose aussi question, notamment pour le Parlement européen qui pourrait ne pas avoir son mot à dire.
La fumée blanche est finalement venue d’Écosse. Réunis à Turnberry, le 27 juillet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, Donald Trump, sont finalement parvenus à un accord transatlantique sur les tarifs douaniers et le commerce. Face au couperet que représentait l’application au 1er août des 30 % de droits de douane « réciproques » promis depuis des semaines par le locataire de la Maison Blanche, Bruxelles a finalement obtenu de Washington la mise en œuvre d’un taux unique de droits de douane à 15 %. Un soulagement du côté du Berlaymont qui considère que le pire a été évité.
En plus des droits de douane, l’UE s’est également engagée à investir, via des entreprises européennes, 600 milliards de dollars (Md$) (environ 550 Md€) dans divers secteurs aux États-Unis d’ici à 2029 et à acheter pour un montant 750 Md$ (environ 700 Md€) de gaz naturel liquéfié, de pétrole et de produits issus de l’énergie nucléaire américains au cours des trois prochaines années.
En contrepartie de la baisse du taux de droits « réciproques », l’exécutif européen s’engage notamment à offrir un meilleur accès au marché pour certaines exportations agricoles américaines non sensibles d’une valeur de 7,5 Md€. Cela s’appliquera à des produits tels que l’huile de soja, les semences de plantation, les céréales ou les noix, ainsi que les produits alimentaires transformés comme le ketchup de tomate, le cacao et les biscuits. Et, l’assure Bruxelles, les produits sensibles comme la viande bovine, le sucre, l’éthanol ou encore le riz ne sont pas inclus dans les discussions.
Des exemptions incertaines
Au-delà de la réduction des droits de douane, la commission a également négocié des exemptions pour certains secteurs clés. Tout ne semble pas encore gravé dans le marbre et de nombreux pourparlers devraient se poursuivre. Des discussions sont, par exemple, en cours concernant les boissons alcoolisées (vins, spiritueux, bières), des secteurs très dépendants du marché américain. La France en a d’ailleurs fait un de ses chevaux de bataille sans pour autant avoir de certitudes.
Le CEEV (commerçants de vins européens), qui pousse aussi pour l’obtention d’un accord zéro pour zéro, met en garde contre la mise en place d’un droit de douane de 15 % sur les vins, soulignant les « pertes économiques importantes non seulement pour les producteurs de vin de l’UE, mais aussi pour les entreprises américaines impliquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement » qu’une telle mesure pourrait engendrer. « Si l’on ajoute à cela une variation de 15 % du taux de change USD/EUR, la charge financière globale pour le secteur pourrait atteindre 30 % », précise l’association. Et d’ajouter : « Les volumes d’exportation pourraient baisser immédiatement de 10 %, ce qui entraînerait des répercussions négatives à long terme sur les parts de marché et les relations commerciales ».
De son côté, le Copa-Cogeca estime également que « le plafond tarifaire proposé de 15 % portera préjudice au secteur agroalimentaire de l’UE et aura probablement un impact négatif sur le marché intérieur ». Il plaide donc pour que « la plus large gamme possible de produits agroalimentaires de l’UE » fasse partie des exemptions. « À défaut, cela risque d’entraîner une asymétrie durable dans nos relations commerciales », précisent-elles.
En France, la Fnsea a, quant à elle, demandé une baisse des taxes sur les engrais importés depuis les États-Unis (autour de 6,5 %). Un point que Bruxelles pourrait soutenir et qui va dans le sens d’une réduction de sa dépendance aux importations russes. Enfin, dans leurs communiqués, la Coopération agricole et Pactalim plaident pour que le « 0 % pour 0 % » soit atteint pour un maximum de produits agricoles et alimentaires, la Coopération précisant les « vins/spiritueux, produits laitiers, boulangerie/viennoiserie/pâtisserie a minima ».
Pas touche au sanitaire
Autre sujet d’inquiétudes, le traitement des normes sanitaires de l’UE. Il faut dire que les interprétations au sujet du contenu de la coopération entre les parties divergent des deux côtés de l’Atlantique. Dans sa fiche d’information publiée le 28 juillet, la Maison Blanche affirme que l’UE et les États-Unis se sont engagés à « travailler ensemble pour éliminer les barrières non tarifaires qui affectent le commerce des produits alimentaires et agricoles, notamment en simplifiant les exigences relatives aux certificats sanitaires pour le porc et les produits laitiers américains ».
Une mention qui a entraîné une levée de boucliers dans l’UE, notamment de la Fnsea et la Coopération agricole. La Commission européenne affirme pourtant qu’elle n’a fait aucune concession en matière de sécurité alimentaire ou de droit de réglementer. Interpellé sur le sujet. Un représentant de la commission a reconnu que la rationalisation des exigences en matière de certificats a été un point de discussion tout en précisant que « cela signifie changer le type de formulaire utilisé ». « On ne bouge pas sur nos réglementations, on ne modifie pas nos règles, on n’abandonne pas le système que nous avons construit depuis des années et qui suscite la confiance de nos citoyens », a-t-il conclu.
Une forme juridique nébuleuse
Si les détails techniques et le contenu de ce qui a été négocié entre la Commission européenne et l’administration Trump suscitent inquiétudes et interrogations, les contours juridiques de cet accord posent aussi des questions.
Une chose semble certaine, la Commission européenne ne devrait pas passer par un accord commercial classique dont la procédure prendrait trop de temps pour aboutir à sa mise en application.
Un professeur de droit à Science Po Rennes, avance que l’UE et les États-Unis ne devraient pas conclure un accord sur le plan formel. Il explique que l’exécutif européen n’a pas la compétence pour conclure un traité dans certains des domaines couverts (énergie, investissement, armement) et qu’un tel format « mettrait l’UE en contravention avec ses engagements OMC et l’exposerait à une plainte d’un pays tiers (notamment de la Chine) ». Selon lui, la solution trouvée pourrait avoir pour conséquence le contournement du Parlement européen dont l’approbation ne serait même pas nécessaire pour que les dispositions s’appliquent. Un destin que souhaite absolument éviter le social-démocrate allemand Bernd Lange, président de la commission du Commerce international du Parlement européen.
De Sefcovic à Macron : entre soulagement et inquiétudes »
Je suis 100 % sûr que cet accord est meilleur qu’une guerre commerciale avec les États-Unis », a affirmé le commissaire européen Maros Sefcovic, le 28 juillet à l’occasion d’une conférence de presse. Alors que Bruxelles tente de défendre son accord, l’annonce conjointe d’Ursula Von der Leyen et de Donald Trump a provoqué un tollé unanime en France.
Le président Emmanuel Macron a déploré le manque de puissance de l’UE dans la négociation, n’arrivant pas à se faire « craindre » par le président américain. Et il prévient : « Nous n’en resterons pas là ! ». Son Premier ministre, François Bayrou, est allé encore plus loin, évoquant « un jour sombre » et accusant la présidente de la Commission européenne de « soumission » tandis que Benjamin Haddad, le ministre de l’Europe, parle d’un accord commercial « déséquilibré ». Plus pragmatique, le chancelier allemand Friedrich Merz salue un compromis qui permet d’éviter « une escalade inutile » même s’il n’est pas satisfait du résultat final. De son côté, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, réputée proche du pouvoir américain, est soulagée d’avoir évité une guerre commerciale mais souhaite analyser le compromis dans ses détails.
Trump conclut des « deals » et sanctionne le Brésil
Au-delà de l’UE, le président américain a conclu des multiples accords avec ses partenaires commerciaux. Dernier en date : la Corée du Sud qui a finalisé, le 30 juillet, un compromis avec Washington. Comme l’UE, ses exportations en direction des États-Unis seront dorénavant taxées à hauteur de 15 % (contre 25 % initialement).
Ce pays vient s’ajouter au Japon (15 % au lieu de 25 %), à l’Indonésie (19 % contre 32 %) ou encore aux Philippines (19 % contre 20 %). Le Royaume-Uni a, lui, réussi à négocier un taux de droit de douane de 10 %, en moyenne. De son côté, le Brésil du président Luis Inacio Lula da Silva se voit, lui, sanctionné de son traitement accordé à son prédécesseur Jair Bolsonaro.
Le locataire de la Maison Blanche a décidé, le 30 juillet, de porter le montant des droits de douane à 50 % afin de « faire face aux politiques, pratiques et actions récentes du gouvernement brésilien » qu’il considère être « une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale » des États-Unis. Certains produits alimentaires, comme le jus d’orange ou les noix, et certains engrais en sont exemptés.








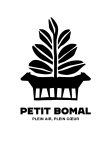
-autox150.png)