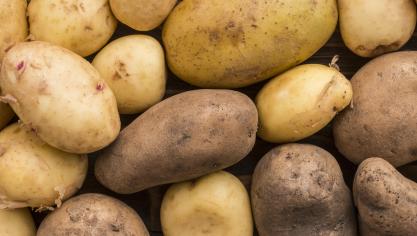Foncier : l’attractivité durable d’un patrimoine sous contraintes multiples
Face aux mutations climatiques, aux déséquilibres économiques et à une géopolitique de plus en plus instable, la terre, ressource rare et précieuse, attire toujours les investisseurs à la recherche de sens et de stabilité. Directeur d’Agrifrance, la filiale foncière de BNP Paribas, Benoît Léchenault a proposé, lors d’une conférence au siège bruxellois de la banque, une lecture fine d’un marché rural en recomposition, entre résistance conjoncturelle et promesses de long terme.

« Il s’agit d’un actif tangible, non coté, déconnecté des marchés financiers traditionnels », résume Benoît Léchenault. Le marché du foncier, en France comme ailleurs, ne s’est pas exempté des grands bouleversements contemporains. Crises sanitaires, inflation post-Covid, tensions géopolitiques, envolée des prix de l’énergie, guerre en Ukraine, fiscalité incertaine… Autant d’éléments venus bousculer les repères des agriculteurs comme des investisseurs.
Un marché en pause après une décennie de croissance
La dynamique haussière des quinze dernières années a pu donner l’illusion d’un marché à progression infinie. Mais « les marchés ne montent pas indéfiniment », tempère Benoît Léchenault. En ce début 2025, le marché du foncier rural connaît un ralentissement logique au vu des incertitudes multiples.

Une année 2024 placée sous le signe de l’excès… d’eau
L’année 2024 a été l’une des plus humides de ces dernières décennies. Mois après mois, les cumuls pluviométriques ont excédé les moyennes, mettant à mal les cultures de rente. Le blé en fait particulièrement les frais, avec des rendements nationaux tombés à 61 quintaux/ha, soit une baisse de plus de 17 %. « On retrouve des niveaux de prix plus proches des moyennes historiques, mais les charges ont explosé ces dernières années », explique M. Léchenault. L’après-Covid, puis la guerre en Ukraine, ont fait grimper les coûts des intrants agricoles (carburants, engrais, matériel) à des niveaux encore partiellement stabilisés. Résultat, les marges se resserrent, et nombre d’exploitants peinent à maintenir un seuil de rentabilité suffisant, en particulier dans les systèmes céréaliers classiques.
Le maïs et le colza, des résultats contrastés
Si le maïs tire son épingle du jeu, grâce à sa capacité à profiter d’un excès d’eau, les prix restent modestes et ne compensent pas entièrement les coûts de production. Le colza affiche quant à lui un cours en progression, mais souffre d’un rendement en retrait, autour de 29 quintaux à l’ha. Ce déséquilibre entre volumes et valeurs illustre bien les tensions qui traversent l’agriculture française. Seules certaines filières s’en sortent, notamment celles intégrant des productions légumières sous irrigation (pommes de terre, oignons, betteraves) qui bénéficient de meilleures marges.
« Il y a une vraie prime à l’irrigation aujourd’hui », affirme Benoît Léchenault. Les exploitations qui ont su évoluer vers des modèles diversifiés, en intégrant la gestion de l’eau, se montrent plus résilientes. Les marges brutes peuvent atteindre jusqu’à 1.800€/ha, contre 800€ dans des systèmes d’assolement classiques.
Le retour en grâce du système polyculture-élevage s’inscrit dans cette logique. Longtemps mis de côté au profit d’une spécialisation poussée, ce modèle retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse. Il permet une fertilisation naturelle, une complémentarité entre cultures et élevage, et une stabilité économique bienvenue. « Ce sont des modèles à revisiter, qui ont du sens dans un monde agricole en mutation. On ne peut plus raisonner comme dans les années 1990 », conclut-il.
Un marché du foncier agricole en recul, mais porteur à long terme
En 2024, selon les données des Safer, le marché du foncier agricole marque un net repli. Pour la première fois depuis 2020, le nombre de transactions passe sous la barre des 100.000, enregistrant une baisse de 5,9 %. Les surfaces cédées diminuent de 5,2 %, à 431 200 ha, tandis que la valeur globale des ventes chute de 17,7 %, à 6,17 milliards €.
Cette contraction s’explique par la conjoncture économique, l’inflation persistante, et une pression accrue sur la rentabilité des exploitations. Les ventes de foncier libre de bail reculent de 16,6 %, quand celles de foncier loué progressent de 7,8 %, traduisant un marché plus orienté vers la stabilité locative que vers la spéculation.
Côté prix, les terres céréalières se négocient en moyenne à 7.760€/ha, en baisse de 1,5 %, tandis que les prairies naturelles redescendent à 5.260 €/ha, soit une baisse de 17,9 %, après une forte hausse en 2023. Les cours du bétail, en particulier du bovin, se maintiennent, mais les éleveurs restent fragilisés par des épizooties à répétition.
Si les prix reculent, les perspectives pour les investisseurs à long terme demeurent solides. Sur la dernière décennie, les prix n’ont progressé que de 1,2 % par an, mais les meilleures terres, celles du Nord-Pas-de-Calais, du Santerre, de la Champagne crayeuse ou de la Vallée de la Durance, s’échangent à plus de 20.000€/ha. À l’autre extrémité, certaines zones d’élevage comme la Mayenne, le Morvan ou l’intérieur de la Côte-d’Or restent accessibles autour de 2.500 €/ha.
Le marché du foncier libre, encore très professionnel, reste conditionné par le rendement économique des parcelles, la qualité des sols, les aménagements (irrigation, structure parcellaire), et les enjeux climatiques. Le volume des transactions agricoles reste faible à l’échelle nationale : moins de 2 % des 28,3 millions ha de terres et prés changent de main chaque année.
Viticulture : une production en repli et une consommation qui évolue
Le vignoble français n’échappe pas aux aléas. En 2024, la récolte nationale chute de 23 %, pour s’établir à 36,1 millions d’hectolitres. Les pluies, les maladies, et une pression sanitaire accrue ont durement frappé les vignes. Seule la Bourgogne tire son épingle du jeu (+36 %), quand la Champagne (-46 %), le Bordelais (-12 %) ou l’Alsace (-13 %) affichent des pertes sévères. La baisse de la production pourrait théoriquement s’accompagner d’une hausse des prix, mais le marché du vin traverse une mutation plus profonde. « Les consommateurs européens traditionnels boivent moins, mais mieux », explique Benoît Léchenault. Cette logique qualitative a certes permis aux vignerons de monter en gamme, mais ne compense pas, à elle seule, la baisse des volumes.
L’exportation : moteur en panne ou en mutation ?
Face à l’érosion de la consommation domestique, la filière française s’est tournée depuis vingt ans vers les marchés extérieurs. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Belgique figurent en tête des débouchés. Mais là encore, les signaux d’alerte se multiplient.

Aux États-Unis, la crainte d’un retour des taxes sous la présidence Trump a provoqué des phénomènes de surstockage en 2024. « On n’en voit pas encore pleinement les effets, mais ils se feront sentir en 2025, avec une baisse attendue des exportations en valeur », prévoit M. Léchenault.
La Belgique, à la fois partenaire fidèle et marché en développement
La Belgique reste un acteur clef du marché du vin français. Les consommateurs y sont réputés pour leur exigence et leur fidélité aux appellations hexagonales, notamment les vins de Bourgogne. Le pays se classe au quatrième rang des importateurs, aussi bien en volume qu’en valeur.
Dans le même temps, la viticulture belge se développe, portée par des capitaux locaux et parfois accompagnée par l’expertise française. « Les volumes sont encore modestes, mais le potentiel est réel. On suit cela de près, comme ce fut le cas au Royaume-Uni », souligne M. Léchenault. Certaines maisons champenoises, sensibles à l’évolution du climat, n’hésitent plus à investir dans ces nouveaux terroirs, perçus comme des extensions stratégiques du vignoble traditionnel.
Une consommation portée par de nouvelles attentes culturelles
Le ralentissement des ventes de vin ne touche pas uniquement la France. En Provence, certaines appellations autrefois très demandées enregistrent un recul des volumes, notamment sur les marchés anglo-saxons, y compris aux États-Unis, où la croissance portée par une clientèle féminine semble marquer le pas.
Cette évolution globale s’inscrit dans une tendance de fond : le recul de la consommation dans les pays historiquement producteurs. En France, elle est passée de 25 à 26 litres par habitant et par an dans les années 1950-60 à une moyenne oscillant entre 10 et 15 litres aujourd’hui. « Le monde change, la société change, et les modes de consommation aussi », observe Benoît Léchenault.
Les jeunes générations adoptent des comportements différents. Plus attirés par la bière ou les spiritueux, ils consomment moins de vin. Mais tout espoir n’est pas perdu. « Il y a un vrai potentiel si l’on dédramatise le vin, si on l’aborde de manière plus accessible, moins élitiste », plaide le directeur d’Agrifrance. Il cite une étude récente montrant que les jeunes sont prêts à découvrir le vin, pour peu qu’on leur en parle avec des codes plus contemporains.
Moins de volumes, mais des bouteilles plus valorisées
Ce « moins mais mieux » se traduit aussi économiquement : moins de bouteilles achetées, mais à un prix plus élevé. Le vin devient un produit d’occasion, associé à des moments choisis, à des expériences qualitatives. « On met le paquet sur une belle bouteille, on cherche l’originalité, la découverte ». Ce phénomène favorise l’émergence de nouveaux terroirs dans le paysage exportateur français. Le chenin d’Anjou, longtemps cantonné à la consommation locale, s’exporte désormais vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Jura, comme autrefois la Savoie, connaît une renaissance : « Des cavistes new-yorkais font déguster des vins du Jura, qu’ils considèrent comme des produits de niche et d’exception ».
Cette évolution du goût pousse les viticulteurs à repenser leur stratégie. Distribution en ligne, réseaux sociaux, marketing expérientiel : « Il faut changer, il faut évoluer », résume M. Léchenault. La tradition ne suffit plus, il faut savoir raconter une histoire, créer du lien, se démarquer. La France conserve toutefois une position de leader mondial en valeur, grâce à ses grands crus et à des produits emblématiques comme le champagne. Mais elle a cédé depuis plusieurs années la première place en volume à l’Italie, dont les vins accompagnent l’essor mondial de la cuisine transalpine. « Ils sont très présents, très bien implantés, avec un marketing offensif. Et ils savent faire du bon vin ». Le prosecco et le cava concurrencent directement le champagne sur certains marchés. « Il ne faut pas s’endormir », prévient Benoît Léchenault.
Une filière stratégique pour la balance commerciale
Les enjeux dépassent la seule viticulture. Avec plus de 15 milliards € de ventes annuelles et un excédent de près de 14 milliards, le vin constitue le deuxième poste excédentaire de la balance commerciale française, derrière l’aéronautique et devant les produits de luxe.
Cette importance explique le poids politique des viticulteurs. Lorsqu’ils manifestent, aux côtés des agriculteurs, leur voix porte jusqu’au plus haut niveau de l’État. « Ce n’est pas seulement une question économique, c’est une question d’identité et de souveraineté », souligne M. Léchenault.
Un monde rural en quête de sens
Le malaise agricole exprimé par les manifestations de 2024 dépasse la seule question viticole. Le projet d’accord de libre-échange avec le Mercosur a cristallisé une exaspération plus large. « Ce traité, perçu comme une menace pour nos filières, n’est qu’un élément parmi d’autres d’un mécontentement profond », analyse Benoît Léchenault.
Les racines sont multiples : inflation, pression réglementaire, normes environnementales, coût du matériel agricole… « Aujourd’hui, un tracteur peut valoir jusqu’à 250.000€. C’est un investissement colossal pour des revenus agricoles qui n’ont pas suivi la même courbe ». Les produits, qu’il s’agisse de céréales ou de vin, ne doublent pas ou ne triplent pas leurs prix, contrairement aux charges. Face au changement climatique, aux mutations sociétales et aux bouleversements économiques, le monde rural est à un tournant. « Il faut écouter ce que disent les agriculteurs. Ils demandent de la cohérence, de la stabilité, et une vision pour l’avenir. »