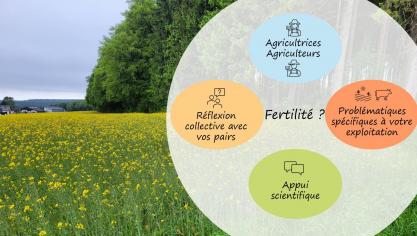L’élevage face au risque d’une transition climatique à contre-sens
Délocalisé au Comité européen des régions, l’intergroupe « élevage durable » a posé, la semaine dernière, une question qui dépasse largement la seule agronomie : quel cadre politique peut permettre aux producteurs européens de rester à la pointe d’un élevage à faibles émissions, sans décrocher économiquement ni vider les campagnes ? Au fil des interventions des élus et des scientifiques, une même tension s’est imposée : réduire les émissions, oui, mais sans déplacer la production ni construire la transition sur l’incertitude, là où celle-ci exige du temps long, de la cohérence et de la confiance.

En ouvrant l’assemblée, Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne et membre du Comité européen des régions, n’a pas choisi a posture défensive. Il est parti d’un fait, presque brut, qui a servi de point d’appui à l’ensemble de son raisonnement : « La Bretagne, c’est 3,5 millions d’habitants… et nous sommes en capacité de produire pour nourrir 20 millions de personnes ».
La Bretagne, un territoire qui nourrit au-delà de ses frontières
Ce rapport d’échelle, insiste-t-il, n’est ni un slogan ni une provocation. Il résume 70 ans de construction agricole sur un territoire qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, était « très pauvre », marqué par des sols acides, et qui s’est structuré, parfois par nécessité plus que par choix, autour de l’élevage, notamment porcin, avicole et bovin laitier.
Derrière ce rappel historique, l’élu pose un cadre politique clair : l’élevage européen n’est pas une variable d’ajustement, mais un pilier de l’autonomie alimentaire. Son argument n’est pas moral, il est physique. « Pour nourrir 450 millions d’Européens, il faut 1.000 milliards de calories par jour », rappelle-t-il, soulignant qu’un système alimentaire ne se remplace ni par des intentions ni par des incantations. « Cela ne se fait pas avec des opinions, mais avec de la science, des sols, du climat et une capacité productive répartie sur l’ensemble du territoire européen. »
Dans ce plaidoyer, l’élevage apparaît non comme un héritage à défendre, mais comme un pivot agronomique. M. Chesnais-Girard insiste sur le rôle structurant des prairies, des cycles de nutriments et du lien entre cultures et animaux. Or, observe-t-il, la baisse des surfaces en herbe et le recul du bovin dans certaines régions, au profit de la céréalisation, posent des questions d’équilibre profondes. « La céréalisation, la végétalisation est une fausse bonne idée si l’on veut travailler les équilibres, que ce soit pour la production alimentaire ou pour la vie des sols. »
Sa critique vise ensuite une transition climatique pensée trop exclusivement à travers le prisme du carbone. « Attention à l’agriculture pilotée par le carbone », avertit-il. Raisonnée à l’échelle territoriale, la comptabilité des émissions pénalise mécaniquement les zones d’élevage, non parce qu’elles seraient moins vertueuses, mais parce que « l’animal, le vivant, c’est du carbone ». Il plaide dès lors pour une approche par unité produite, à la tonne de matière, permettant d’encourager l’amélioration des performances plutôt que la disparition des systèmes.
L’élu breton élargit enfin le débat à la question des dépendances stratégiques. Soja et engrais azotés constituent, rappelle-t-il, deux importations clés du modèle actuel. À l’échelle des ports bretons, « 60 % de l’activité » repose encore sur « le pétrole, l’abonitrate et le soja ». Une impasse, selon lui, si l’Europe veut réellement conjuguer souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire.
L’Europe ne peut pas réduire « ici » pour importer « ailleurs »
Après ce cadrage territorial, Benoît Cassart a relié le débat à l’architecture européenne : objectifs climatiques, revenus agricoles, politique commerciale. Son propos vise à sortir d’un faux dilemme. Oui, l’élevage contribue aux émissions ; non, la solution ne peut pas consister à réduire mécaniquement la production européenne.
L’élu wallon rappelle que des progrès ont déjà été accomplis. Entre 1990 et 2014, les émissions liées à l’élevage ont reculé de 23 %, avant de stagner. Plus récemment, une baisse globale d’environ 6 % des émissions agricoles est observée, principalement portée par l’élevage. Mais ce constat masque une fragilité : en viande bovine, « nous sommes en train de perdre le cheptel européen ».
Sa formule résume l’enjeu : « Diminuer les émissions en diminuant les animaux pour finalement importer plus de viande produite dans des systèmes plus émetteurs que les nôtres, ce n’est pas une stratégie ; c’est un suicide social et environnemental. » Derrière cette mise en garde se dessine le spectre de la fuite carbone : réduire les émissions sur le papier tout en les déplaçant hors d’Europe.
M. Cassart insiste sur l’existence de leviers techniques (santé animale, alimentation, génétique, gestion des effluents) mais rappelle qu’ils ont un coût. « On ne peut pas demander plus de normes, plus de technologie et plus d’investissements sans sécuriser le revenu », martèle-t-il. La cohérence avec la politique commerciale devient alors centrale : exiger des standards élevés tout en ouvrant le marché à des produits moins-disants alimente la défiance agricole.
Il voit enfin dans le carbone agricole un levier potentiel, à condition qu’il repose sur des méthodologies robustes, un registre crédible et une rémunération effective des efforts. L’élevage, insiste-t-il, doit être au cœur de ce dispositif, non comme problème à corriger, mais comme secteur de solutions.
« La transition ne peut pas être construite sur l’incertitude »
Avec Louise Crowley, agricultrice irlandaise, le débat quitte le registre institutionnel pour entrer dans la matière vécue. Son message est direct : les agriculteurs ne refusent pas l’objectif climatique, mais ils ne peuvent l’assumer si les règles changent en permanence.
Elle décrit un système herbager performant, fruit de décennies de progrès en génétique, santé animale et gestion des prairies. Mais « les gains faciles ont été faits », prévient-elle. La suite exige des investissements lourds et une visibilité à long terme. « Nous ne pouvons pas investir des centaines de milliers d’euros si l’environnement politique continue de changer sous nos pieds. »
Son propos se cristallise autour des règles nitrates,
La science du méthane : des promesses techniques sous conditions politiques
Avec l’intervention du chercheur espagnol David Yanez-Ruiz, la discussion quitte le terrain des arbitrages politiques pour s’ancrer dans les mécanismes biologiques qui sous-tendent les émissions de l’élevage. Son propos éclaire l’un des points les plus sensibles du débat climatique : le méthane entérique, responsable d’environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées à l’agriculture européenne.
Surtout, il met en garde contre une approche décontextualisée : une solution efficace dans un système intensif peut se révéler inopérante, voire contre-productive, dans des systèmes herbagers extensifs. À ses yeux, la réduction du méthane ne peut être pensée indépendamment des modèles d’élevage et de leur diversité. Au terme de son intervention, le message est clair : la science fournit des outils prometteurs, mais elle ne peut porter seule la transition. La technologie ouvre des portes ; les politiques publiques décident si elles resteront théoriques ou deviendront opérationnelles.
Le carbone comme trajectoire outillée, auditée et rémunérée
C’est précisément ce passage de la science à l’action qu’illustre Anaïs L’Hôte, ingénieure à l’Institut français de l’élevage (Idele). À travers le projet LIFE Carbon Farming, lancé en 2021 pour six ans, elle expose une approche méthodique du carbone agricole, loin des injonctions abstraites.
L’objectif est double : accompagner les exploitations de polyculture-élevage vers une réduction moyenne de 15 % de leur empreinte carbone et construire un dispositif crédible de reconnaissance et de rémunération des efforts. La démarche repose sur un diagnostic initial intégrant émissions directes et indirectes, mais aussi la séquestration du carbone par les sols, les haies ou les prairies.
Sur cette base, chaque exploitation élabore, avec l’appui de conseillers formés, un plan d’action individualisé parmi une quarantaine de leviers : amélioration de la santé et de la longévité des animaux, autonomie protéique, optimisation des effluents, agroforesterie, sobriété énergétique des bâtiments.
L’un des apports majeurs du projet réside dans son refus d’une lecture exclusivement carbone. « Nous ne raisonnons pas uniquement en tonnes de CO2 », souligne Anaïs L’Hôte. Les impacts sur l’eau, la biodiversité, l’énergie ou le temps de travail sont systématiquement évalués afin d’éviter les effets de déplacement. Mais c’est sur la dimension économique que son propos se fait le plus incisif. « Le coût d’une pratique ne se limite pas à son prix », rappelle-t-elle. Il inclut le risque d’échec, l’aléa climatique, le temps d’apprentissage, l’incertitude sur les résultats. Autant de paramètres rarement intégrés dans les modèles économiques, mais déterminants dans la décision de l’éleveur.
À cela s’ajoute le coût du conseil et de l’accompagnement, indispensables pour sécuriser les trajectoires. Sans formation, sans suivi et sans stabilité réglementaire, le carbone agricole risque de rester un dispositif marginal. « Le carbone ne peut pas être une sanction, il doit devenir une trajectoire lisible, auditée et rémunérée », résume-t-elle.
Au terme de la matinée, une ligne de crête se dessine. L’Europe dispose de solutions techniques et d’une ambition climatique affirmée. Mais elle ne peut ni réduire « chez elle » pour importer « ailleurs », ni bâtir la transition sur l’instabilité réglementaire. La question n’est plus seulement celle des objectifs, mais celle de la méthode, de la cohérence et de la confiance. Dans un secteur où les décisions se prennent à 10 ans, la confiance est déjà une politique.