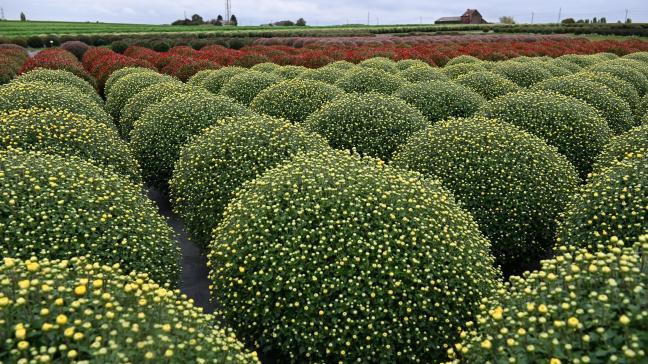le Bon Dieu ! »

Noël 1570, forêt de Florenville… Les doigts de Dieu
Ghislain s’est assis sur un rocher pour se reposer ; ses vingt ans sont bien loin, quand il pouvait courir des lieues sans s’essouffler… Son cœur cogne à tout rompre dans sa poitrine et ses jambes flageolent de fatigue, après avoir grimpé le raidillon encombré de broussailles et de ronces entrelacées. Pourtant, il ne songe pas un instant à renoncer : cet arbre, il faut qu’il le retrouve, absolument ! Le doigt de Dieu l’a désigné clairement. La nuit dernière, veille de la Nativité, la...
Article réservé aux abonnés
Accédez à l'intégralité du site et recevez Le Sillon Belge toutes les semaines
Déjà abonné au journal ?
Se connecter ou Activez votre accès numérique