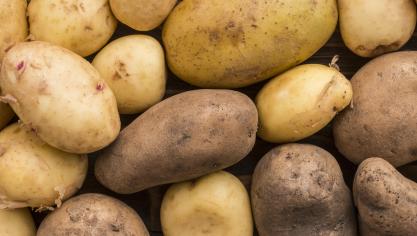«L’Afsca est un partenaire de confiance pour les agriculteurs»
Administrateur délégué de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) depuis 2014, Herman Diricks revient, à l’heure de clore son mandat, sur les grandes orientations prises par l’agence au cours de la dernière décennie. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il insiste sur la nécessité d’un contrôle rigoureux mais juste, répond aux critiques récurrentes du monde agricole, et défend une approche holistique de la chaîne alimentaire, de l’agriculteur au consommateur.

Dix ans à la tête de l’Afsca, c’est une décennie de vigilance, d’ajustements, de modernisation, mais aussi de gestion des soubresauts qui ont agité le secteur agroalimentaire.
Depuis votre prise de fonction à la tête de l’Afsca en 2014, quelles ont été vos grandes priorités stratégiques ?
Lorsque j’ai été nommé Administrateur de l’Afsca, le 1er mai 2014, l’agence était déjà bien structurée. Il fallait d’abord assurer la continuité. Mais nous avons aussi réfléchi en profondeur, avec l’équipe de direction, à nos orientations à moyen terme. Nous avons ainsi adopté des plans stratégiques et opérationnels à trois ans, qui sont venus baliser nos priorités et les rendre lisibles pour l’ensemble des parties prenantes. Un travail important a aussi été mené autour de la mission et de la vision de l’Afsca. Au-delà de l’obligation légale, il nous fallait donner du sens à notre action au quotidien. Nous avons ainsi fait le choix de placer le consommateur au centre de notre vision. Cela implique une approche « chaîne alimentaire » intégrée, de la ferme au point de vente, en veillant à chaque maillon. Évidemment, nous avons aussi dû composer avec des contraintes budgétaires importantes. Depuis 2014, les gouvernements successifs ont imposé des réductions de moyens. Chaque année, nous avons dû faire des arbitrages pour maintenir notre niveau d’exigence en matière de sécurité alimentaire.
Comment l’Afsca collabore-t-elle concrètement avec le monde agricole ?
Notre organisation comprend plusieurs directions générales. Celle chargée de la politique de contrôle joue un rôle central dans les relations avec les parties prenantes agricoles. Nous organisons des réunions régulières avec les fédérations professionnelles, tant au nord qu’au sud du pays. C’est dans ces enceintes que sont débattues les nouveautés réglementaires ou les mesures à venir. En parallèle, je préside le comité consultatif de l’agence, où l’ensemble des secteurs sont représentés. Les questions agricoles y occupent naturellement une place importante, en particulier lorsqu’elles touchent aux maladies animales, qui peuvent avoir des conséquences pour toute la chaîne en aval.
Quels sont les retours concrets de l’Afsca vers le secteur agricole ?
On oublie souvent que l’Afsca n’est pas seulement une autorité de contrôle, mais aussi un soutien concret au secteur en cas de crise. Lorsque des maladies animales apparaissent, l’agence prend en charge un large éventail de frais opérationnels : le nettoyage et la désinfection des exploitations touchées, la destruction des animaux infectés, les analyses de laboratoire, etc. Ces interventions représentent des montants significatifs, qui soulagent directement les agriculteurs concernés. Ainsi, en 2024, l’Afsca a consacré 3,5 millions € à la gestion de la grippe aviaire, et 1,7 million € à celle de la FCO. Ces sommes sont issues du budget de l’agence et couvrent des coûts que les opérateurs devraient, dans d’autres circonstances, assumer eux-mêmes. L’épisode du fipronil en 2017, lorsqu’e cet insecticide interdit a été détecté dans des élevages de poules pondeuses, a également donné lieu à des indemnités spécifiques. L’Afsca a collaboré étroitement avec ses homologues aux Pays-Bas, en Allemagne et ailleurs, pour assurer une traçabilité maximale des produits contaminés et contenir la crise à l’échelle européenne. Le Fonds sanitaire intervient quant à lui sur la valeur des animaux, tandis que l’Afsca se charge des aspects logistiques et sanitaires. Il faut le souligner : le secteur agricole est celui qui bénéficie le plus de ces retours directs, comparé à d’autres branches de la chaîne alimentaire. Ces aides sont essentielles pour assurer la résilience du secteur en période de crise et montrent que notre rôle ne se limite pas à sanctionner, mais également à protéger et accompagner.
Certains agriculteurs vous accusent de multiplier les contrôles dans les exploitations. Que leur répondez-vous ?
C’est une perception que je comprends, mais qui ne correspond pas à la réalité. En moyenne, un agriculteur ne fait l’objet d’un contrôle que tous les 8 à 10 ans. Certains en subissent davantage, mais c’est souvent parce qu’ils mènent des activités complémentaires (vente directe, boucherie à la ferme) qui sont, elles, soumises à des fréquences de contrôle plus élevées. Par ailleurs, de nombreux contrôles ne sont pas réalisés par l’Afsca mais par d’autres instances : auditeurs privés pour les cahiers des charges, autorités régionales… Cette confusion contribue à alimenter un sentiment de harcèlement injustifié. Et il faut le souligner, lorsqu’un exploitant a déjà passé avec succès un audit privé dans le cadre d’un cahier des charges, il est bien mieux préparé pour le contrôle de l’agence, qui en devient souvent plus simple et plus fluide. Les chiffres sont éloquents : en 2024, le taux de conformité dans le secteur agricole s’élève à 90,6 %. Sur les 8.243 missions de contrôle réalisées, seuls 240 procès-verbaux ont été dressés, soit moins de 3 % des inspections ayant donné lieu à une infraction constatée. Une performance qui témoigne du professionnalisme de la grande majorité des exploitants.
Et du côté phytosanitaire, quels sont les risques majeurs auxquels vous faites face ?
Le végétal souffre d’un déficit de reconnaissance, sans doute parce qu’il ne touche pas directement à la santé publique. Pourtant, les menaces sont bien réelles. L’introduction d’organismes exotiques peut entraîner des pertes économiques colossales. Nous avons, par exemple, repéré la bactérie Xylella fastidiosa, transmissible via des oliviers importés. Ou encore l’insecte Bactrocera dorsalis, détecté sur des fruits, heureusement, sans foyer établi. Notre petite taille nous protège parfois : les maladies doivent souvent traverser d’autres pays avant d’arriver en Belgique. Mais une introduction directe reste possible, et nous devons donc maintenir une veille constante.
Accompagnez-vous le secteur agricole dans ses efforts de durabilité ?
Oui, indirectement. La durabilité est de compétence régionale. Mais lorsque certaines pratiques durables touchent à la sécurité de la chaîne, nous agissons. C’est le cas, par exemple, dans le développement des circuits courts, que nous encadrons avec rigueur pour garantir la confiance du consommateur.
Comment travaillez-vous avec les syndicats agricoles
De façon concertée et équilibrée. Nous discutons avec les organisations du nord comme du sud, sur toutes les questions réglementaires où une marge nationale existe. Par exemple, dans la mise en œuvre du règlement européen sur les pesticides et l’obligation d’un registre électronique, nous avons anticipé les besoins et permis au secteur d’adapter ses outils. Plus largement, nous publions des guides, des circulaires explicatives, et proposons des formations à la demande du secteur, notamment via notre service de vulgarisation. Celui-ci traite également des centaines de questions chaque année.
Comment l’Afsca veille-t-elle à ce que ses missions de contrôle soient perçues comme justes et constructives sur le terrain ?
L’inspection fait partie de notre mission, mais nous mettons tout en œuvre pour qu’elle se déroule dans un climat de respect mutuel. Les résultats sont bons, et l’agence fait preuve de souplesse lorsque les circonstances le justifient. Nous investissons aussi dans la digitalisation pour faciliter les interactions, et nous organisons régulièrement des enquêtes de satisfaction. Le dialogue avec le terrain est essentiel, et il s’est amélioré ces dernières années.
On connaît moins votre rôle dans l’accès aux marchés internationaux. Quelle est votre stratégie ?
Nous avons par exemple réussi à rouvrir le marché chinois à la viande porcine après la peste porcine africaine. Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres : en 2024, nous avons obtenu l’exportation de poires, chicons et poivrons vers la Chine, de produits laitiers vers le Salvador, ou encore de poires vers le Pérou. Nous avons même un attaché à la sécurité alimentaire en Chine. L’Afsca est ainsi une vitrine de notre crédibilité sanitaire, à la fois pour l’exportation et au sein de l’UE.
Auriez-vous un dernier message à adresser aux agriculteurs avant de quitter vos fonctions à la tête de l’Afsca ?
Qu’ils n’aient pas peur de l’Afsca. Nous sommes un partenaire de confiance, à l’écoute du terrain. Nous comprenons leurs contraintes, et nous sommes convaincus qu’une bonne compréhension mutuelle entre l’agence et le secteur est la clef d’une chaîne alimentaire forte, durable et respectée. La qualité de notre dialogue s’est améliorée avec le temps, et nous avons tous à y gagner : le contrôle, lorsqu’il est bien compris, devient un outil de valorisation pour le producteur. Nous investissons aussi beaucoup dans la préparation à l’imprévu. Une cellule de crise est en place, et nous menons régulièrement des exercices de simulation pour être prêts en cas d’émergence sanitaire, qu’elle soit animale ou végétale. Ce professionnalisme, cette anticipation, c’est aussi ce qui permet de rassurer nos partenaires commerciaux à l’étranger et d’assurer aux agriculteurs belges un accès durable aux marchés. Enfin, l’Afsca est consciente des mutations à l’œuvre dans l’alimentation et dans l’agriculture. Nous ne sommes pas une organisation figée : nous dialoguons, nous nous adaptons. Et c’est cela, à mes yeux, le véritable garant de notre pertinence.