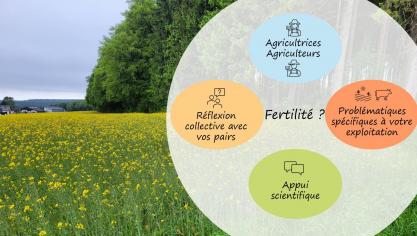Moins de pesticides, plus d’alternatives… mais sans impact sur la rentabilité
Rassembler l’écosystème agricole wallon pour réfléchir, filière par filière, comment réduire le recours aux produits de protection des plantes et favoriser les alternatives. Telle est l’ambition des États généraux de la protection des cultures, annoncés au printemps dernier par Anne-Catherine Dalcq. Aujourd’hui lancée, la démarche se veut pragmatique. Elle entend, en effet, préserver la rentabilité des fermes et offrir aux agriculteurs un vade-mecum de techniques concrètes à mobiliser au quotidien.

Théâtre de nombreuses grands-messes agricoles, l’Espace Senghor (Gembloux) accueillait la séance inaugurale des États généraux de la protection des cultures, le 31 octobre. Devant un parterre de scientifiques, membres des centres pilotes, agriculteurs ou encore représentants du secteur, la ministre wallonne de l’Agriculture, Anne-Catherine Dalcq, n’a pas manqué de rappeler la raison d’être de cet ambitieux chantier, réalisé sous la houlette du Centre wallon de recherches agronomiques (Cra-w).
Dans le dialogue, le partage de savoirs et l’action
« J’entends souvent que tel ou tel produit est retiré du marché, mais qu’il n’existe aucune alternative à son utilisation. Ce qui peut mettre les agriculteurs dans des situations complexes. En parallèle, malgré un usage très encadré, les produits phytopharmaceutiques présentent un risque pour la santé, notamment des utilisateurs, mais aussi pour l’environnement », déroule Anne-Catherine Dalcq. Si le débat autour des pesticides divise, elle souhaite que ces États généraux de la protection des cultures soient le départ d’une nouvelle manière d’avancer. « Sans culpabilité ni procès d’intention, mais dans le dialogue, le partage de savoirs et l’action. Avec une vision : moins de pesticides, mais plus d’alternatives pour les agriculteurs. »

En la matière, la Wallonie ne part pas de nulle part. Des agriculteurs innovent déjà, des chercheurs mènent des essais, des entreprises développent des biostimulants et autres produits de biocontrôle, des variétés résistantes sont disponibles… Il est donc temps de faire un état des lieux de ce qui existe, selon la ministre.
L’objectif de ce chantier sera donc de créer des liens entre les pratiques, les savoirs et les réalités de terrain. Une stratégie cohérente, applicable effectivement et rapidement en ferme doit en découler, tout en respectant les contraintes et les réalités de chacun. « Mais avec la ferme volonté de diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires », complète-t-elle. Cette réflexion semble nécessaire si l’on souhaite que les cultivateurs s’inscrivent pleinement dans cette démarche, sans impact sur la souveraineté alimentaire et la viabilité du secteur.
Un constat partagé : réduire l’utilisation de pesticides
Avant la tenue de ces États généraux, le débat sur les produits de protection des plantes et leur utilisation s’est invité au Parlement de Wallonie. Ces derniers mois, de nombreuses auditions ont eu lieu au sein de la commission « Santé », sur le thème « Les effets sanitaires et environnementaux des pesticides », mais aussi au sein de la commission conjointe « Agriculture-Santé », ayant pour thématique « Les pesticides et leurs enjeux pour l’agriculture et la ruralité ».
Au cours de celles-ci, experts et organisations se sont succédé à la tribune, pour être auditionnés par les parlementaires. Sans être exhaustif, se sont notamment exprimés durant une trentaine d’heures : la Société scientifique de médecine générale, l’administration wallonne, les syndicats agricoles, des professeurs d’université, plusieurs associations environnementales, la Cour des comptes, le Cra-w… C’est dire si le panel visé était large et ciblait les divers aspects du dossier.
Différents constats ont été posés lors de ces discussions. Véronique Durenne, députée wallonne et rapporteuse de ces auditions, en a détaillé quelques-uns.
Ainsi, la nécessité de diminuer l’utilisation des produits de synthèse est acceptée par l’ensemble des intervenants. « Il nous a été rappelé à quel point les agriculteurs sont les premiers concernés sur le plan sanitaire, notamment avec le risque d’apparition de la maladie de Parkinson », présente-t-elle. Les experts ont alerté sur la présence de traces de produits phyto dans l’eau, le sol et l’air et sur la perte de biodiversité. « La majorité des scientifiques a indiqué qu’il y avait également des risques pour les consommateurs et riverains de parcelles agricoles », ajoute-t-elle.

En vrac, les personnes auditionnées ont aussi mis en avant la nécessité de renforcer la protection des captages d’eau et zones habitées, d’étendre l’interdiction de pulvérisation autour des lieux sensibles occupés par un public vulnérable et d’avoir une meilleure gestion et transparence des données liées à l’utilisation des produits phytosanitaires.
À noter que ces constats émanent des intervenants entendus lors des auditions, chacun apportant sa propre lecture du dossier. Les acteurs du monde agricole restent libres d’y souscrire pleinement ou partiellement.
Sans oublier la rentabilité !
Si tous reconnaissent la nécessité de réduire l’usage des produits de synthèse, la question de la rentabilité a aussi été au cœur des débats. « Cependant, tous les intervenants n’étaient pas en accord sur la viabilité économique et la praticabilité des différentes alternatives présentées au sein de nos réunions », concède Mme Durenne. Point important à mentionner dans la foulée : la différence a bien été faite entre rentabilité et rendement. « La première notion étant bien évidemment la plus essentielle, et celle à préserver, voire renforcer. » L’importance de faire coexister plusieurs modes de production a aussi été mise en avant.
Dans ce contexte, des solutions innovantes et intéressantes ont été présentées par le monde de la recherche. Ce dernier plaide, par la même occasion, pour que les agriculteurs soient mieux informés au sujet de ces alternatives et rappelle qu’elles ne peuvent être adoptées durablement que si les conditions économiques, techniques et structurelles de leur usage sont réunies. « Enfin, pour eux, il est essentiel que la Wallonie renforce son soutien à la réalisation d’essais en conditions réelles, au suivi de fermes pilotes, et à l’accompagnement technique. »
Nul ne doute que ces pistes seront exposées et explorées, voire approfondies, dans le cadre des États généraux de la protection des cultures.
Une boîte à outils que chacun pourra s’approprier
En pratique, ce chantier s’articulera autour de neuf groupes de travail : pommes de terre, céréales, maïs fourrage, maraîchage pour le marché du frais, maraîchage pour l’industrie, betteraves et chicorées, oléoprotéagineux, horticulture comestible et horticulture non comestible. Leur mission commune : dresser un état des lieux complet de la situation actuelle, des outils de protection disponibles, des techniques culturales, de ce qui est déjà testé et peut encore l’être, de la sélection variétale, des innovations en matière de mécanisation ou encore de biocontrôle…
En œuvrant sous ce format, les États généraux permettront à chaque culture de faire entendre ses spécificités et défis mais aussi ses leviers d’actions et perspectives. Outre les centres pilotes, les syndicats seront présents autour de la table, pour chaque filière, ainsi que tous les acteurs pouvant apporter des pistes de solution, tous domaines confondus.
L’influence des changements climatiques fera également partie des discussions. Pourquoi ? Car ils obligent, depuis plusieurs années déjà, à repenser les manières de travailler.
Pour chaque culture, se dégageront des alternatives à court, moyen et long terme. Elles seront accompagnées d’une analyse économique. Et si aucune autre voie n’existe, des priorités seront fixées pour le monde de la recherche.
« L’objectif n’est pas de fragiliser notre agriculture mais bien de la renforcer en lui donnant les outils pour produire mieux, sans compromettre ni la santé, ni l’environnement, ni la sécurité alimentaire. Et sans opposer bio et conventionnel ! », ajoute Anne-Catherine Dalcq.
Un vade-mecum au printemps prochain
Les travaux se prolongeront jusqu’en février. Ensuite, un vade-mecum regroupant des alternatives concrètes aux produits de protection des plantes sera rendu disponible pour tous les agriculteurs wallons. « Nous allons proposer une boîte à outils que chaque agriculteur pourra adapter à sa réalité de terrain. Car la Wallonie, bien qu’étant un petit territoire, est très diversifiée », insiste la ministre.
Et de conclure : « Nous ferons ainsi de la Wallonie une région qui innove, qui protège, qui avance, qui peut être leader de la diminution de l’utilisation des pesticides sans mettre en difficulté les agriculteurs ».