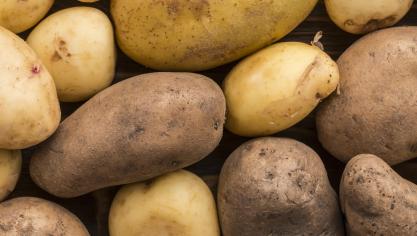les leçons de la pandémie

Ainsi, si la valeur de la production du secteur agricole a diminué de 1,4 % en 2020 par rapport à 2019, elle a augmenté en revanche de 2,9 % par rapport à la moyenne 2015-2019. Sans surprise, ce sont les secteurs fortement dépendants des services de restauration qui ont rencontré des difficultés majeures. Les secteurs des fleurs et des plantes, ainsi que du sucre, ont également subi des pertes financières considérables.
Main-d’œuvre et excédents de production
L...
Article réservé aux abonnés
Accédez à l'intégralité du site et recevez Le Sillon Belge toutes les semaines
Déjà abonné au journal ?
Se connecter ou Activez votre accès numérique