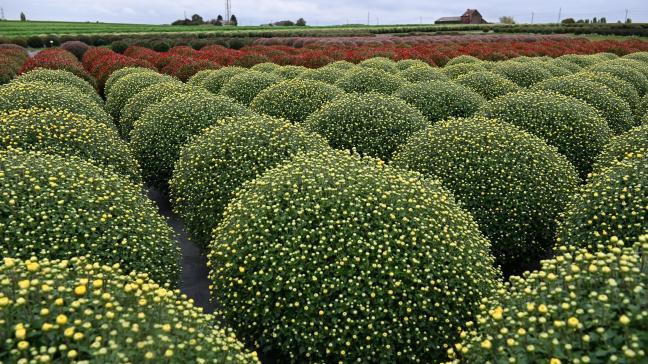Fegra et Bfa, les fédérations belges du négoce en grains et des fabricants d’aliments pour animaux, ont à nouveau effectué cette année un suivi ciblé afin de déterminer la présence de mycotoxines dans le maïs après la récolte (à titre d’alerte précoce ou « Early warning »). Ce monitoring est effectué depuis plusieurs années déjà dans l’objectif de collecter des données et de mettre les résultats d’analyse à la disposition des utilisateurs de maïs dès que possible après la récolte.
Le rapport pour la récolte 2024 est basé sur 93 ...
Article réservé aux abonnés
Accédez à l'intégralité du site et recevez Le Sillon Belge toutes les semaines
Déjà abonné au journal ?
Se connecter ou Activez votre accès numérique