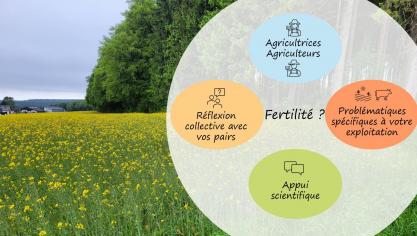Quel avenir pour les phyto en Belgique?
Si de nombreuses mesures visent à limiter les risques liés à l’usage de produits phytosanitaires, l’évaluation des matières actives devient plus stricte, entraînant davantage de retraits que d’homologations. Pour concilier disponibilité des phyto et réduction de leurs impacts sur la santé et l’environnement, deux pistes émergent : favoriser l’accès aux moyens de protection à faible risque et préserver les solutions existantes en les couplant à une application ciblée.

Mi-novembre, le Service public fédéral (Spf) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a tenu sa traditionnelle session d’information et de discussion sur les produits pharmaceutiques. L’occasion pour Maarten Trybou, chef du service produits phytopharmaceutiques et engrais, de livrer la réflexion des autorités fédérales quant à l’avenir des produits de protection des plantes et ce, dans un contexte de moindre disponibilité des matières actives.
Protéger les eaux de surface…
Rappelons tout d’abord que le Comité d’agréation des produits phytopharmaceutiques à usage agricole évolue dans un cadre strict et doit, entre autres tenir compte des mesures d’atténuation des risques prévues dans le plan d’action national pour la réduction des pesticides (Napan). Celui-ci s’articule autour de cinq grands thèmes : la protection des eaux de surfaces, la protection des riverains, l’orientation des utilisateurs vers des produits plus sûrs, la sensibilisation et la recherche.
En vue d’assurer le respect du premier objectif M. Trybou rappelle qu’il existe des mesures de réduction de la dérive. « Nous mettons régulièrement à jour l’arrêté ministériel listant l’ensemble des buses homologuées en la matière », insiste-t-il. Ses services travaillent également à l’élaboration d’un arrêté royal imposant une réduction minimale de la dérive de 75 % pour tous les produits phytosanitaires (contre 50 % actuellement).

D’autres mesures sont prises, avec l’instauration de zones tampons (ZT). Celles-ci sont propres à chaque produit et, pour rappel, leur largeur dépend du type de buses anti-dérive équipant le pulvérisateur. Il s’agit de la ZT « étiquette », fixée par le Comité d’agréation sur base d’une analyse de risque. En parallèle, les ZT « minimales » constituent des mesures régionales et ne dépendent pas du produit appliqué. Leur largeur (1 à 6 m) varie selon la nature de la zone à protéger.
« Dans la pratique, nous constatons que les ZT « minimales » ne sont pas toujours bien appliquées. C’est pourquoi nous essayons désormais de nous coordonner avec les Régions pour reprendre cette matière dans notre giron. Ces ZT sont, en effet, plus faciles à expliquer et contrôler. Nous voudrions étudier quelles seraient les implications si nous nous limitons à celles-ci. Il s’agit toutefois d’un exercice difficile qui risque d’entraîner la disparition de certains produits. Nous espérons donc pouvoir les maintenir suffisamment larges. »
Il existe aussi des plans spécifiques de réduction des émissions pour un certain nombre de substances actives problématiques que l’on retrouve régulièrement dans les eaux de surfaces et qui dépassent parfois les normes établies. « Nous avons conclu une charte avec les détenteurs d’autorisation en vue de travailler ensemble aux respects de ces normes. Le but : éviter que les produits appliqués se retrouvent là où ils ne devraient pas. » Les problèmes se manifestant fréquemment dans les mêmes zones, la possibilité d’établir un plan de réduction des émissions par zone est à l’étude.
Enfin, la question d’inclure, ou non, les métabolites ainsi que les eaux souterraines dans les différentes normes est analysée.
… et les riverains
L’instauration de zones tampons destinées à protéger les riverains d’une éventuelle exposition aux produits de protection des plantes a déjà été évoquée. Cependant, cela demeure complexe pour les autorités fédérales, étant donné l’existence de réglementations régionales relatives à ce même groupe cible. Maarten Trybou espère désormais que les Régions présenteront elles-mêmes des pistes en la matière.
« Aujourd’hui, personne n’est satisfait »
Pour orienter les utilisateurs vers davantage de sûreté plusieurs pistes sont évoquées. Elles concernent tant les amateurs que les professionnels. Ainsi, pour les premiers, l’instauration de restrictions supplémentaires est évoquée.
À l’étude également, une taxation intelligente, dépendant de la nocivité et/ou des risques inhérents au produit utilisé. « Nous avons également identifié des produits à faibles risques, notamment pour les amateurs. Malheureusement, ils sont souvent moins connus… », ajoute Maarten Trybou. Enfin, dans le cadre de son plan d’action, le Spf travaille sur une vision d’avenir : « Comment la société voit-elle l’évolution de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à long terme ? ».
« Si l’on résume, nous souhaitons aboutir à une utilisation durable des produits de protection des plantes. Cela, en tenant compte des piliers économique, social et environnemental. Mais nous faisons face à un problème… D’une part, les agriculteurs doivent disposer des outils nécessaires à l’exercice de leur profession, alors que de nombreuses matières actives ont déjà été soustraites du marché. D’autre part, nous devons tenir compte des effets de la phytopharmacie sur la santé et l’environnement. » Or, le processus d’évaluation des matières actives devient de plus en plus sévère. Par conséquent, le nombre de retrait du marché est supérieur aux nouvelles agréations.
Dans la foulée, M. Trybou se montre quelque peu pessimiste. Il craint, en effet, que l’on manque un jour de solutions face aux maladies et ravageurs rencontrés. Avec des conséquences en matière de résistance. « C’est pour éviter cette situation que le Napan doit développer une vision d’avenir de l’utilisation des produits de protection des plantes. D’autant qu’aujourd’hui, personne n’est satisfait. Ni les agriculteurs, car le nombre de matières actives disponibles chute, ni les citoyens, qui ont une perception croissante de leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement. »
Mêler produits à faible risque et application ciblée
Afin de maintenir suffisamment de produits sur le marché tout en limitant leurs effets sur la santé et l’environnement, Maarten Trybou évoque deux pistes : stimuler l’accès au marché des produits à faible risque et maintenir les solutions existantes en les couplant à une application ciblée.
Concernant les produits à faible risque, il s’agit surtout de produits naturels, tels que des biopesticides, mais aussi d’agents synthétiques qui sont considérés comme étant des alternatives aux produits déjà disparus. Pour stimuler leur mise sur le marché et leur utilisation, ils sont prioritairement mis à l’ordre du jour lorsque le Comité d’agréation des produits phyto se réunit. Ils sont également plus facilement identifiables sur la plateforme en ligne Phytoweb (www.fytoweb.be). « Seuls 33 sont actuellement agréés. Nous espérons que d’autres suivent. »
Du côté du second volet, les autorités constatent que les biopesticides ne sont pas toujours aussi efficaces que les produits de synthèse. « Nous avons besoin de les maintenir, que ce soit pour des usages essentiels, des urgences… » La piste évoquée consiste à conditionner leur utilisation à un mode de d’application n’occasionnant qu’une exposition limitée ou acceptable des organismes non-cibles.
« Il existe peut-être de nouvelles méthodes d’applications ciblées, tels les drones et les robots. On pense aussi au système de transfert clos permettant d’incorporer tout produit dans le pulvérisateur par le biais d’un dispositif empêchant les contacts entre l’utilisateur et ledit produit. Au fur et à mesure que ces pistes se développeront, nous les intégrerons aux autorisations de mise sur le marché. »
Outre les mesures génériques, des dispositions spécifiques, propres à certaines matières actives, sont amenées à voir le jour. « Nous devons avoir la garantie que les produits concernés seront appliqués dans le respect de ces restrictions. Nous ne savons pas encore exactement quelles seraient ces spécificités, mais nous devons avancer sur le dossier. En effet, de plus en plus de substances dont l’emploi est conditionné par des mesures d’atténuation des risques arrivent sur le marché. »
Parmi les pistes évoquées, figurent la création d’une phytolicence spécifique, l’établissement de contrat entre le distributeur et l’utilisateur, ou encore l’instauration de prescription… « Il s’agit d’un amalgame de solutions… Ce qui est loin d’être idéal ! Nous devrons étudier, en collaboration avec les détenteurs d’autorisation, ce qui est faisable. Et de toute urgence ! »