La recherche sur le mildiou de la pomme de terre…pour une amélioration continue de la prévention
Le mildiou demeure l’ennemi numéro un de la pomme de terre. Avec divers partenaires, le Centre wallon de recherches agronomiques s’applique à traquer l’évolution du pathogène responsable, cerner le comportement des nouvelles variétés plus tolérantes, évaluer plus efficacement les risques en saison, spatialiser les données météo… dans un même but : améliorer le système d’avertissements Vigimap pour une lutte encore plus raisonnée. Le point, en compagnie de Vincent César, du Cra-w.

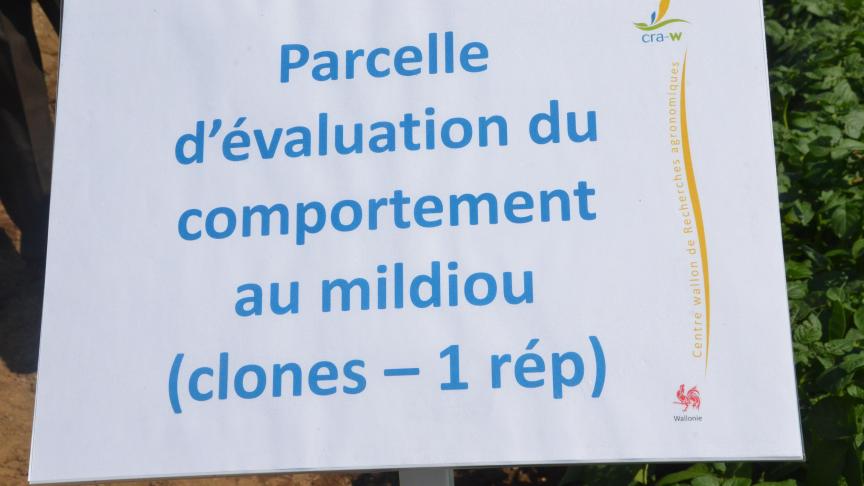
Causé par Phytophthora infestans, le mildiou constitue la principale maladie de la pomme de terre. Sa distribution est mondiale, on le retrouve partout où celle-ci est cultivée, de l’Amérique jusqu’à la Chine. Le mildiou peut être très dommageable lorsqu’il rencontre les conditions météorologiques particulièrement propices à son développement. Les producteurs en Belgique se souviennent des étés très pluvieux survenus en 2012, 2014 et 2016, très favorables à la maladie, et ce, à l’inverse des trois dernières années très sèches 2017, 2018 et...
Article réservé aux abonnés
Accédez à l'intégralité du site et recevez Le Sillon Belge toutes les semaines
Déjà abonné au journal ?
Se connecter ou Activez votre accès numérique




